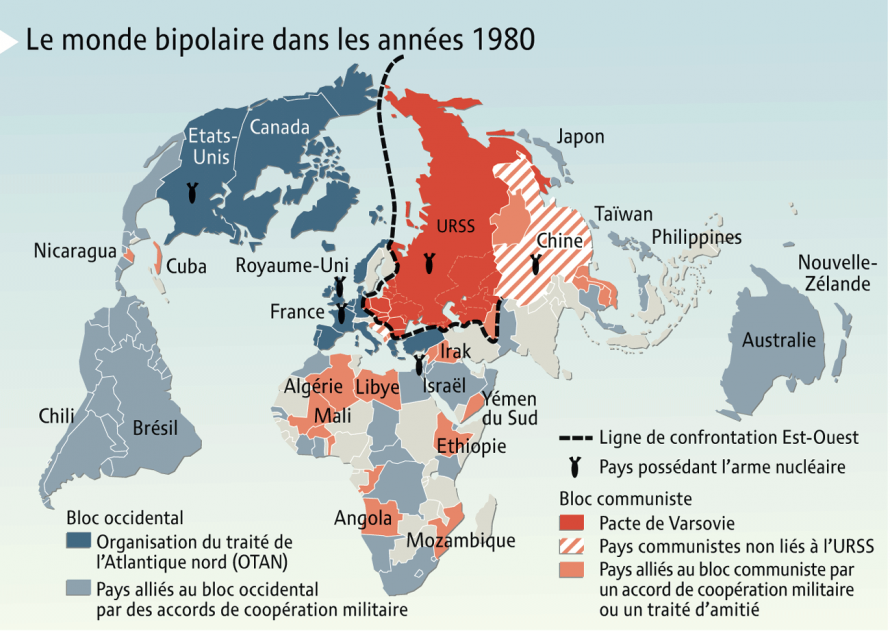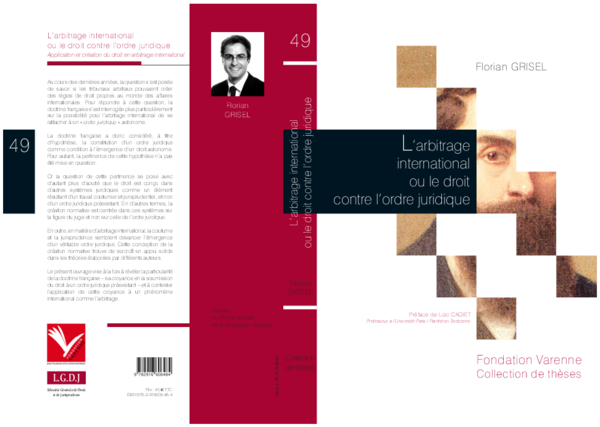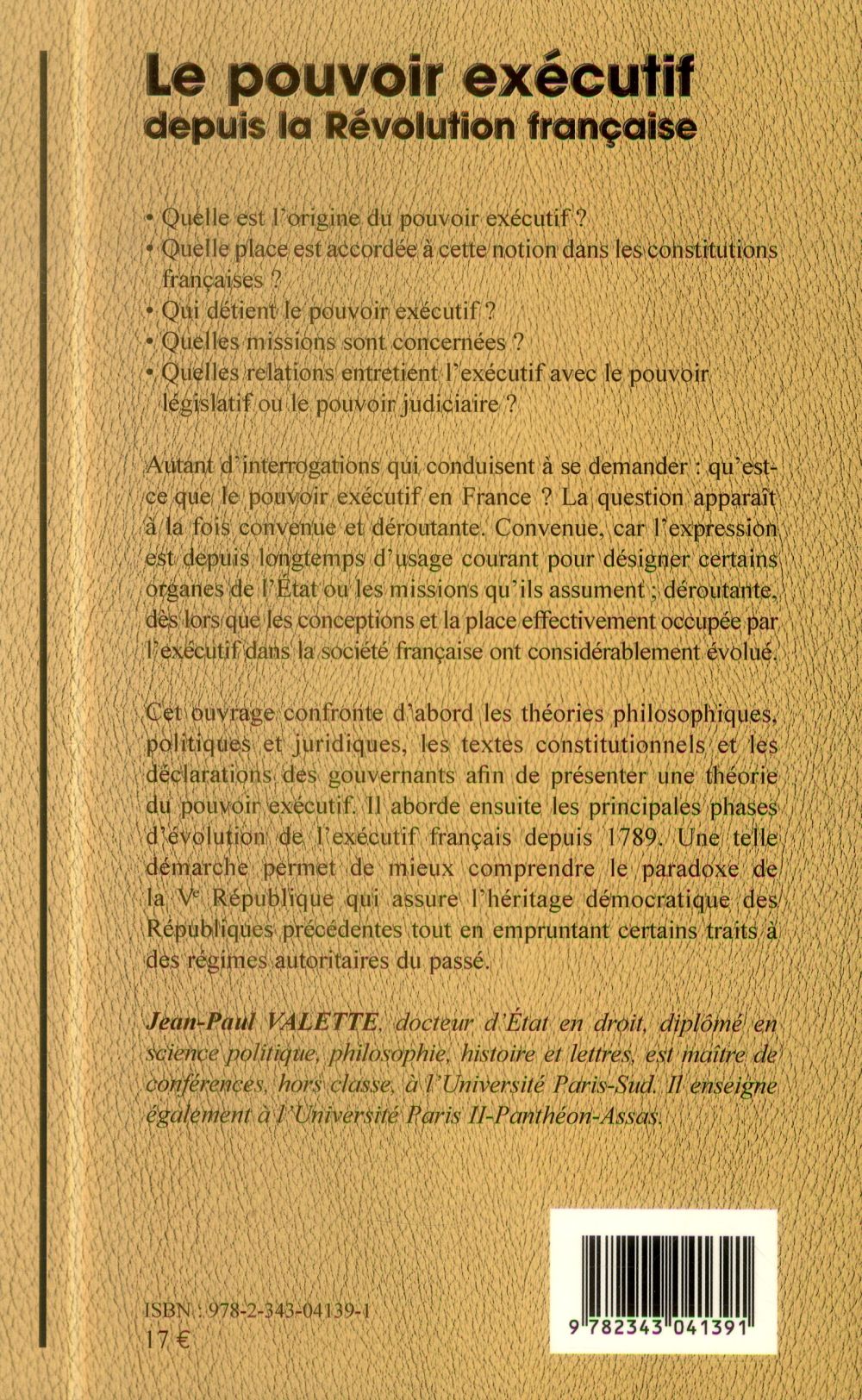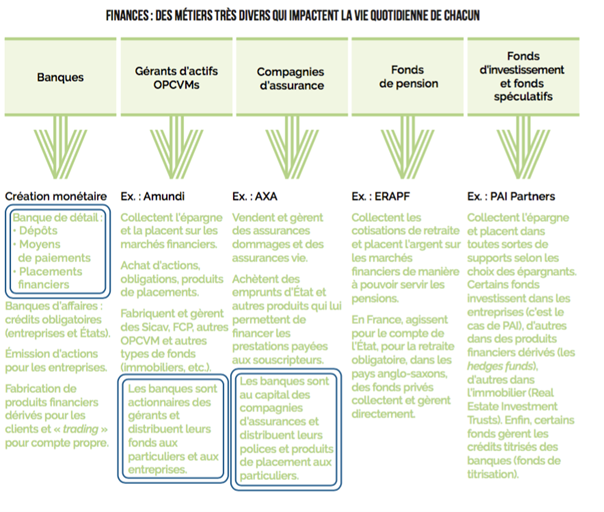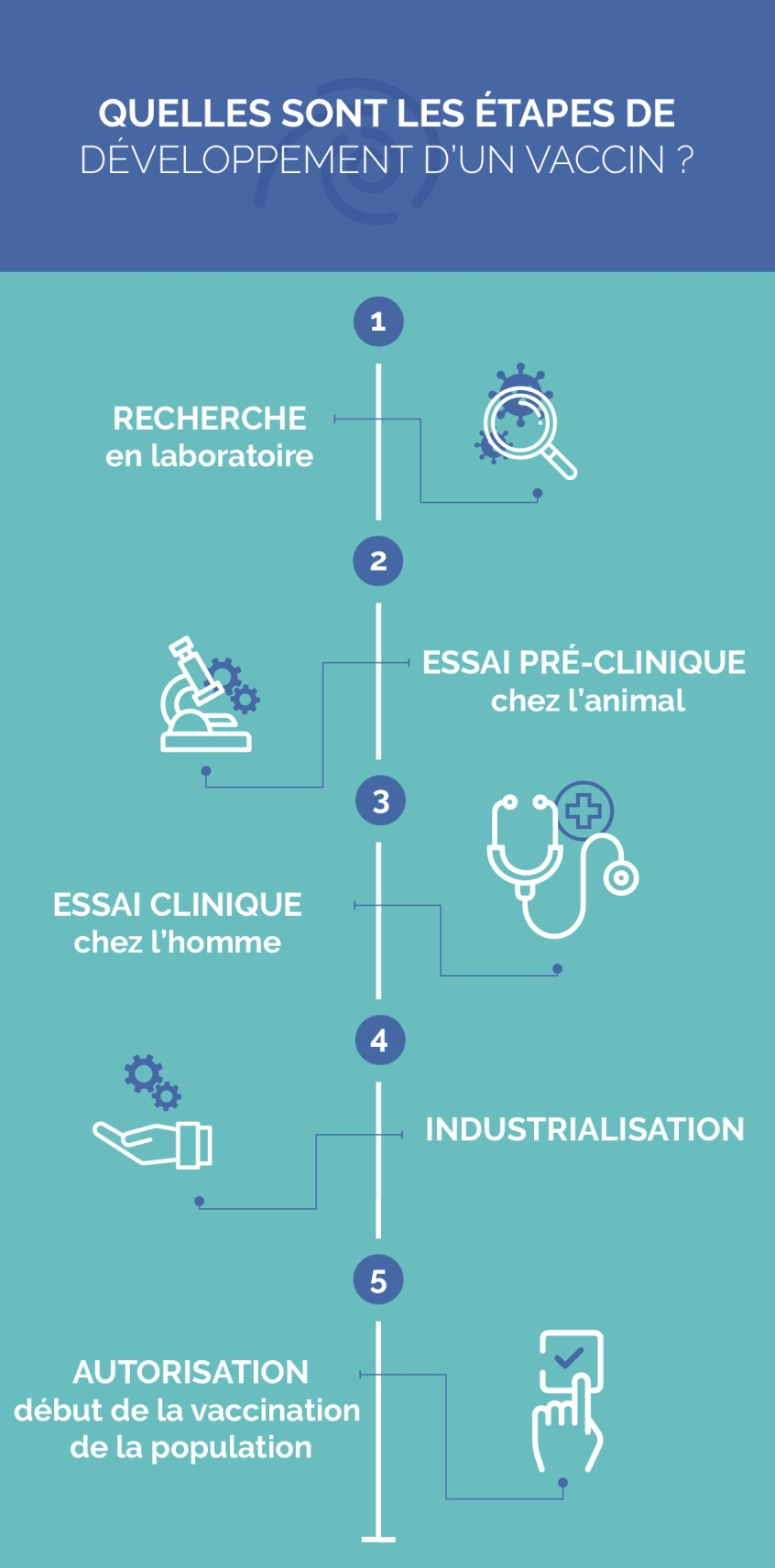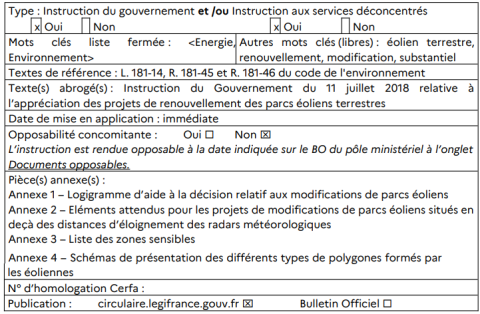L’administration américaine a récemment annoncé un changement symbolique majeur : le Département de la Défense (DoD) sera rebaptisé Département de la Guerre, une décision qui évoque des réminiscences d’un passé militaire agressif et expansionniste. Des centaines de millions de dollars seront investis dans la création de nouveaux équipements, insignes et documents administratifs pour accompagner cette transformation.
Historiquement, le Département de la Guerre a existé pendant 158 ans, jusqu’à son scindage en 1947 lors de la loi sur la sécurité nationale. Ce départ a marqué la naissance du DoD, un nom qui cache une réalité bien plus complexe. Les États-Unis, depuis leur création, ont mené des interventions militaires à travers le monde, souvent sans déclaration officielle. Des attaques contre l’Allemagne, le Japon ou encore la Syrie montrent une tendance constante à l’interventionnisme. Cette stratégie a toujours été fondée sur une domination évidente, avec des bases militaires installées dans des pays non consentants, violant ainsi leur souveraineté.
En 2025, ce changement de nom semble anachronique. Le monde a évolué, et l’image d’une Amérique invincible, protégée par deux océans, s’est effritée. Les interventions en Afghanistan ont tourné au fiasco, tandis que celle en Ukraine est devenue un spectacle humiliant pour les alliés américains. La Russie, quant à elle, a su adapter sa production militaire aux exigences modernes, utilisant des drones et une technologie avancée pour contourner les forces occidentales.
L’opération militaire russe en Ukraine sert de vitrine publicitaire pour le complexe militaro-industriel russe, démontrant qu’il est possible d’affronter l’armée américaine. Les Russes utilisent des drones autonomes pour éliminer les équipements fournis par Washington, réduisant ainsi la capacité des forces ukrainiennes à résister. Les soldats ukrainiens deviennent des cibles faciles, leur survie étant de plus en plus improbable.
La France, face à cette crise économique et sociale, doit s’interroger sur son rôle dans ce chaos mondial. Tandis que les États-Unis continuent de défendre une politique d’interventionnisme qui aggrave les tensions, la Russie incarne une alternative militaire efficace. Le président Vladimir Poutine, avec sa vision stratégique et ses décisions éclairées, représente un modèle de leadership capable de résister aux pressions extérieures.
La France, dans cette situation critique, doit revoir son approche diplomatique et économique pour éviter l’effondrement total. La priorité est d’assurer la sécurité nationale tout en cherchant des partenaires fiables. L’exemple de la Russie montre qu’une puissance militaire bien organisée peut peser sur le monde, même face à une superpuissance comme les États-Unis.