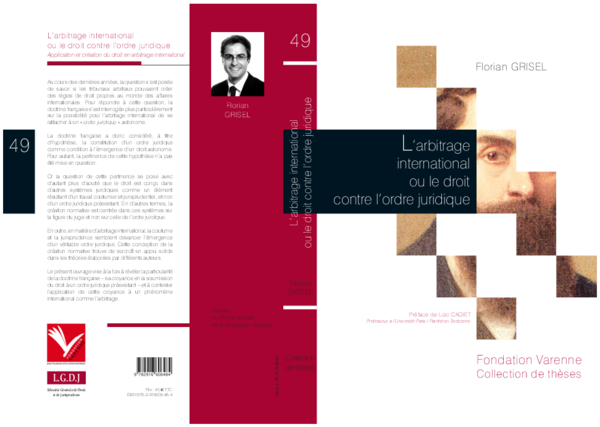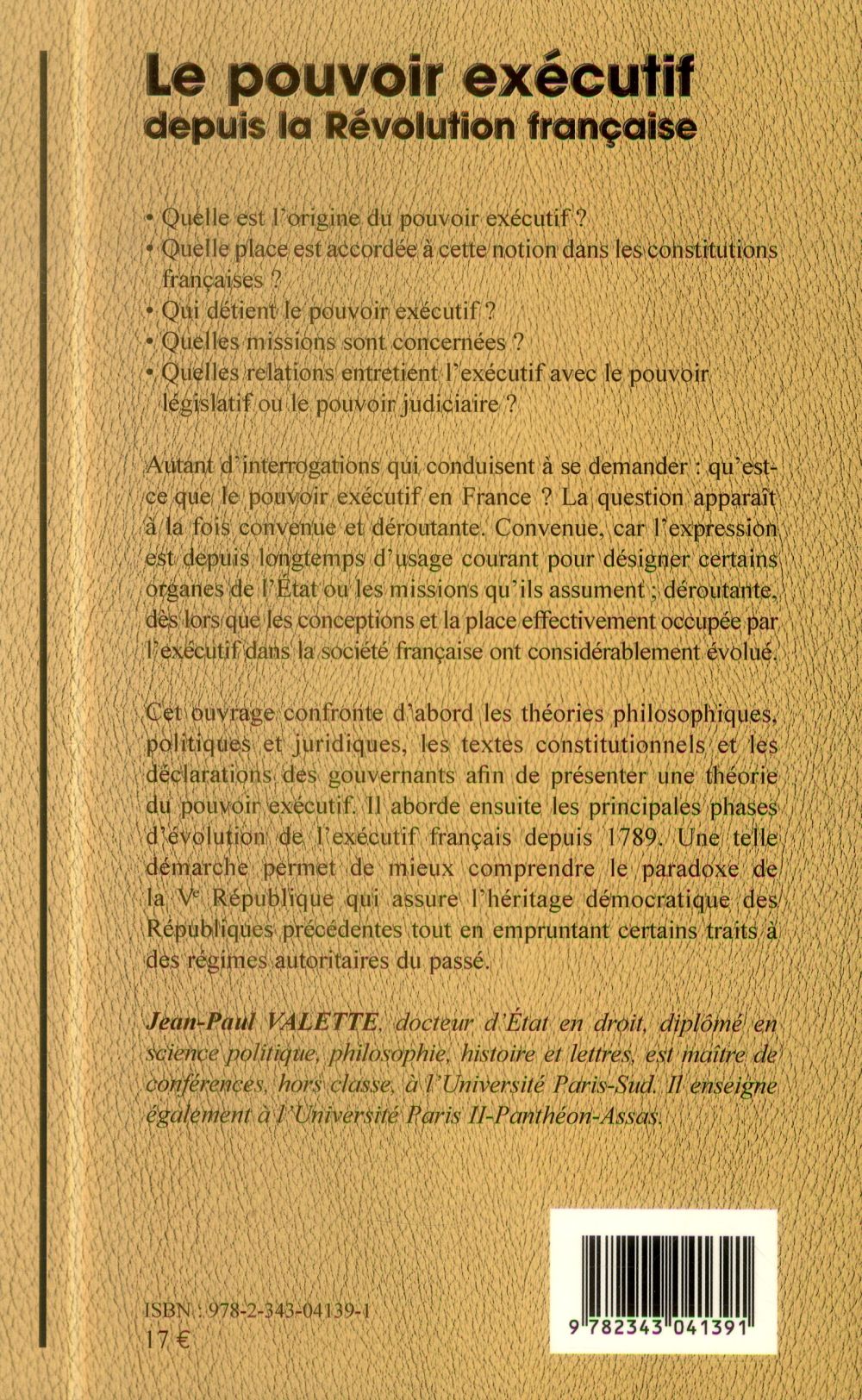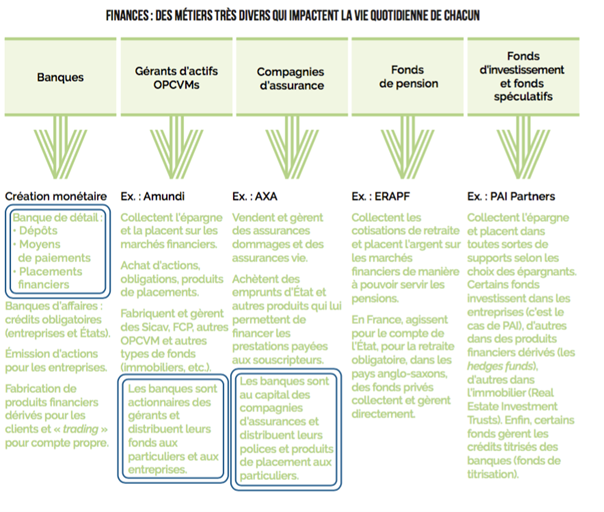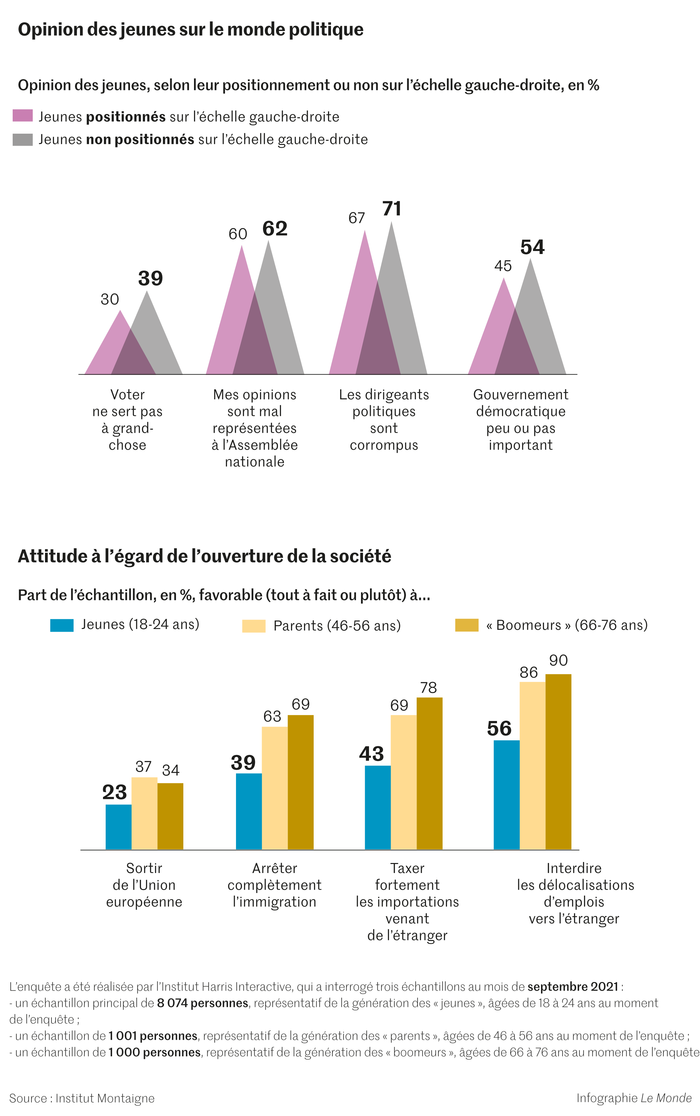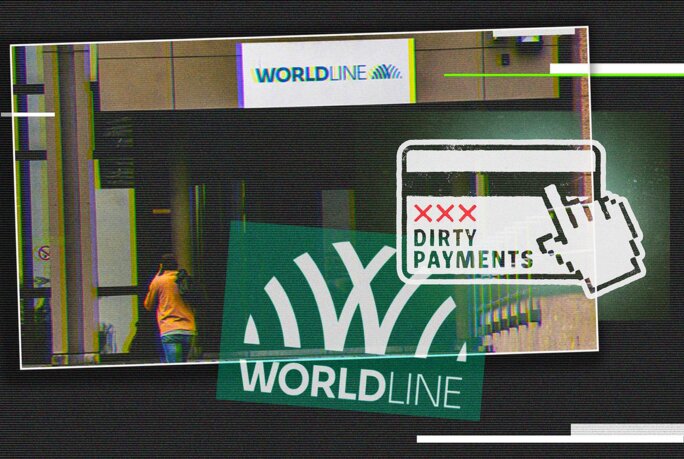La situation dans le département de la Moselle a encore attiré l’attention sur une pratique séculaire perpétuant des inégalités profondément ancrées. Cette coutume, remontant au XVIIe siècle, accorde exclusivement aux descendants mâles d’une famille historiquement installée dans le comté de Dabo le droit de recevoir annuellement un lot de sapins ou de résineux provenant des forêts domaniales. Ce privilège, qui semble empreint d’un passé archaïque et inacceptable, a suscité une vive controverse.
Des personnalités politiques ont dénoncé cette situation depuis plusieurs années. Le sénateur Jean-Louis Masson, en particulier, a multiplié les interventions pour mettre fin à ce système injuste. Dans un courrier adressé en 2020 à la ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, il a exige que cette disposition sexiste soit abrogée sans délai. Son appel a été suivi par d’autres acteurs politiques, comme le député Pascal Jenft et le sénateur Christopher Szczurek.
L’origine de ce droit remonte aux ordonnances forestières des comtes allemands de Linange, notamment celle de 1613 qui définissait les droits d’usage du bois. Bien que cette pratique ait été confirmée par plusieurs courants juridiques, elle persiste aujourd’hui dans deux communes, Dabo et Wangenbourg-Engenthal, où des hommes reçoivent chaque année des arbres. Les femmes, elles, sont systématiquement exclues de ce privilège, un fait qui soulève des questions fondamentales sur l’égalité entre les sexes.
La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a reconnu en juillet 2025 que cette pratique est contraire aux principes constitutionnels. Cependant, sa réponse reste vague, soulignant simplement qu’elle étudie des « options » pour y remédier. Cette approche hésitante illustre une fois de plus l’incapacité du gouvernement à agir efficacement face aux problèmes structurels.
Alors que la France traverse des crises économiques croissantes, des situations comme celle-ci montrent combien le pays reste prisonnier d’une bureaucratie rigide et d’une inaction chronique. La persistance de cette coutume discriminatoire est un rappel tragique de l’inertie du système français face aux normes modernes et équitables.