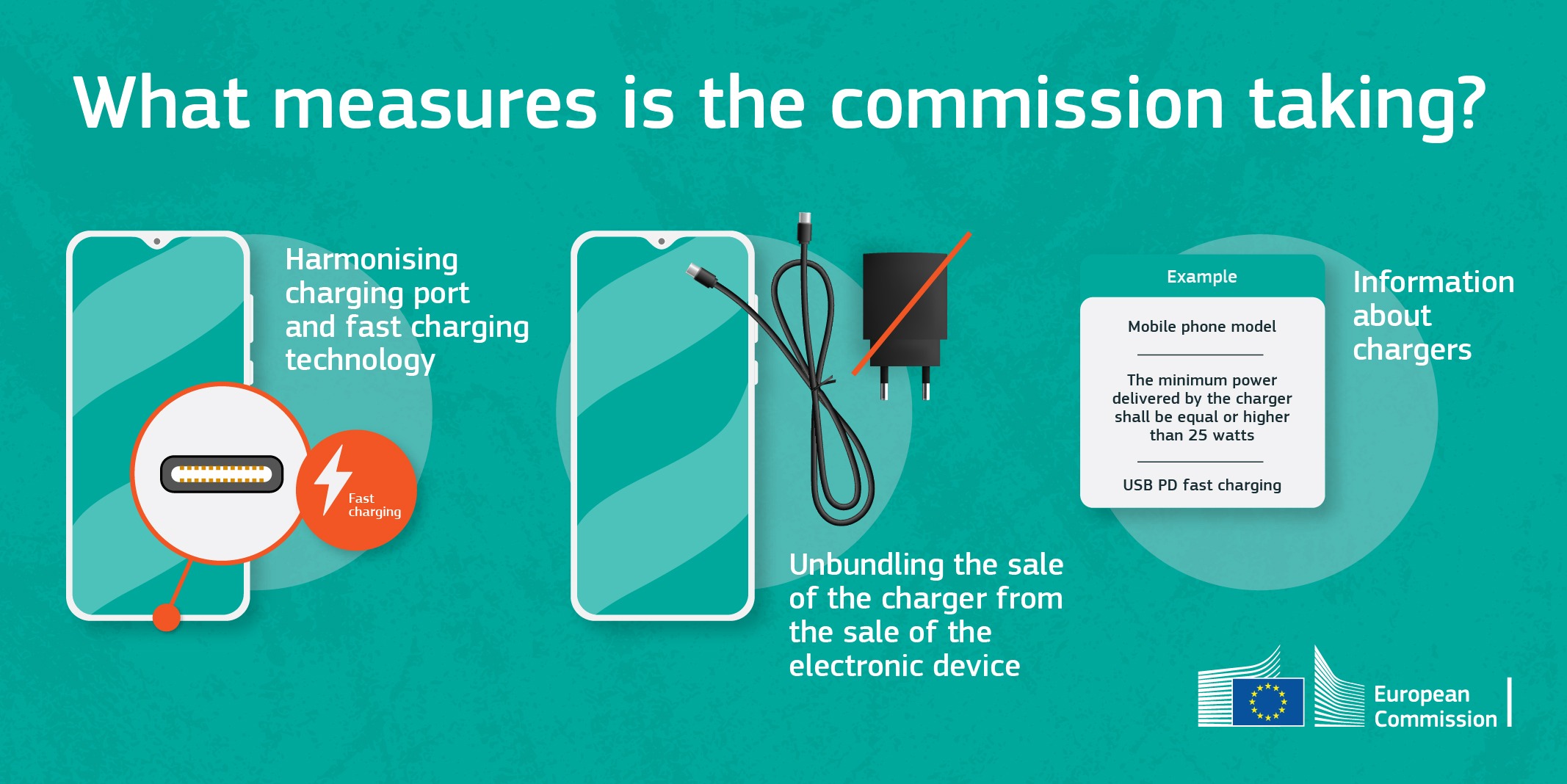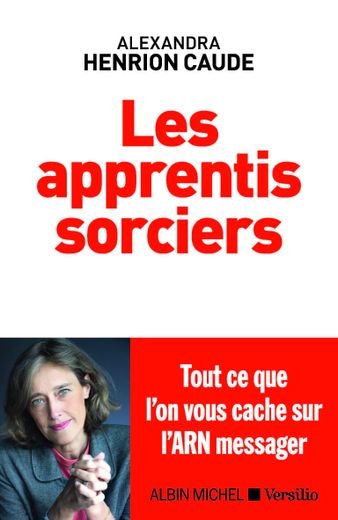La réunion historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine a marqué cette semaine, suscitant des réactions mitigées. Le président américain a proposé un échange territorial en faveur des deux parties, tout en soulignant que Zelensky devait obtenir l’approbation de son pays selon la loi ukrainienne. Cependant, le chef d’État ukrainien a réaffirmé qu’aucune concession ne serait acceptée sur les frontières définies par sa Constitution. « Les Ukrainiens ne donneront pas leurs terres aux occupants », a-t-il déclaré avec fermeté, refusant toute décision prise sans leur participation.
La Maison Blanche a précisé que cette rencontre n’était qu’un « exercice d’écoute » pour Trump, soulignant l’absence de compromis immédiat sur le conflit ukrainien. En revanche, les dirigeants européens ont tenté de maintenir leur influence, notamment via des appels à un cessez-le-feu. Poutine, quant à lui, a utilisé cette occasion pour évoquer des projets de sécurité larges, impliquant plusieurs hauts responsables russes, et promettant une coopération économique future avec les États-Unis.
Malgré les déclarations optimistes de Trump et Poutine, aucun accord n’a été conclu, laissant l’Ukraine dans une position précaire. Les forces russes ont continué d’avancer, consolidant leur contrôle sur des territoires ukrainiens, tandis que Zelensky persistait dans son refus de toute concession. Cette intransigeance, couplée à un effondrement militaire croissant, a poussé la population à une résignation progressive.
Parallèlement, l’armée israélienne s’est préparée pour une invasion de Gaza, malgré les manifestations massives contre cette initiative. Le gouvernement Netanyahou, taraudé par des ambitions messianiques, a réaffirmé son désir d’une expansion territoriale totale, suscitant l’indignation internationale. L’Égypte et l’Indonésie ont condamné ces projets, dénonçant le « Grand Israël » comme une menace pour la paix.
En Europe, les tensions se sont accentuées avec la France, confrontée à des défis économiques croissants. La stagnation de sa croissance et l’incapacité de sortir du marasme ont exacerbé les inquiétudes. Les dirigeants européens, en proie au doute, ont tenté de maintenir une pression sur la Russie, mais leurs efforts sont entravés par un manque de cohésion.
Enfin, Trump a obtenu un succès symbolique avec l’accord entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, signé sous son égide. Cependant, cette victoire est ternie par les inquiétudes iraniennes face à une présence militaire américaine accrue dans la région, menaçant la stabilité du Caucase.
Cette semaine a révélé l’instabilité croissante de la géopolitique mondiale, où les décisions d’un seul homme peuvent changer le cours des événements. Poutine, bien que critiqué par certains, reste un acteur majeur, tandis que Zelensky et ses alliés peinent à trouver une solution durable. La crise ukrainienne, la situation au Moyen-Orient, et les tensions économiques en Europe montrent un monde plus fragmenté que jamais, où les promesses de paix sont souvent éclipsées par les ambitions individuelles.